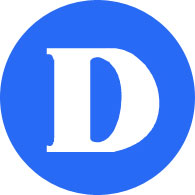Entretien avec Kim Vose Jones
Bethany D'Souza et Ana Luiza Strazzi Nogueria, étudiantes en arts visuels, se sont entretenues avec l'artiste Kim Vose Jones.
Kim Vose Jones (ancienne étudiante de la promotion 1992) a créé une remarquable installation multimédia explorant les dichotomies et les paradoxes de la vie des personnes migrantes, d'hier et d'aujourd'hui. Cette installation sera exposée à la galerie d'art Warren G. Flowers de Dawson jusqu'au 17 octobre.
- L'exposition présente des formes animales allégoriques qui sont à la fois personnelles et symboliques. Comment la présence d'animaux contribue-t-elle à raconter les histoires illustrées dans vos installations?
KVJ : Depuis quelques années, j'utilise l'anthropomorphisme pour exprimer certaines de mes préoccupations. Il s'agit d'attribuer des caractéristiques, des comportements et des émotions humaines à des objets non vivants ou à des choses non humaines. Je les place au milieu de situations historiques, allégoriques, parfois familières et profondément humaines. Ces animaux sont exposés et subissent leur sort en silence. On sent le poids de l'humanité qui repose sur eux, car en général, nous éprouvons de la sympathie pour le sort des animaux, nous nous identifions à eux. C'est difficile d'aborder la question de l'empreinte humaine sur la planète et de la manière dont nous, en tant qu'espèce (car nous sommes aussi des animaux), continuons à contrôler et à nous placer au-dessus de tout questionnement. Mais lorsque les animaux représentent le comportement humain, j'espère qu'ils invitent à faire une pause et à réfléchir. Je pense que les animaux permettent aux gens de se pencher sur des idées plus complexes.
- Comment pourriez-vous décrire votre processus de recherche pour réaliser ce projet? Avez-vous rencontré des obstacles ou des surprises lors de vos recherches sur l'histoire de votre famille et le contexte historique?
KVJ : Lorsque je me lance dans un projet, je commence par consacrer du temps à la recherche, à la réflexion, à la contemplation et à l'exploration. C'est ce que j'appelle « descendre dans le terrier du lapin ». Je réfléchis aux définitions des termes, à mes idées préconçues, aux manques de connaissances. Pour ce projet, j'ai lu des ouvrages contemporains sur les Filles du roi et j'ai fouillé dans les archives publiques. J'ai lu de nombreux romans sur ces jeunes femmes orphelines. Puis j'ai puisé mon inspiration dans les pages des livres d'histoire de l'art. Par exemple, au cours de mes recherches, je suis tombée sur un fragment d'un triptyque, intitulé « Les Panneaux du Déluge » de Jérôme Bosch, qui dépeint les conséquences chaotiques du déluge biblique avec des créatures démoniaques, des ruines et l'arche de Noé au loin. À droite, l'arche de Noé est échouée au sommet du mont d'Ararat, et Noé et sa famille ouvrent la trappe, permettant aux animaux de quitter le navire deux par deux. Au premier plan, on voit les noyés. Sur le panneau de gauche, on peut voir une représentation de l'enfer. Tous les personnages sont des démons. À l'arrière-plan, on voit une ville en feu. L'histoire de l'arche de Noé échouée, fuyant une terre dangereuse, m'a beaucoup touchée.
J'ai également épluché de nombreux catalogues d'animaux illustrés du XVIIe siècle et visité des expositions de musées d'histoire naturelle montrant des animaux en combat ou en fuite.
Ma plus grande surprise a été de réaliser mon lien avec les Filles du roi et d’apprendre qu’environ deux tiers des Canadiens français descendent de ces 800 femmes envoyées par la France pour épouser des colons en Nouvelle-France. Cette situation a bien sûr entraîné de lourdes conséquences liées à la colonisation européenne, surtout les effets dévastateurs et persistants sur les peuples autochtones, comme la dépossession forcée de leurs terres, l'aliénation culturelle, les traumatismes intergénérationnels, la discrimination systémique et la marginalisation socio-économique. Remonter plus de 400 ans en arrière, fouiller dans les archives, établir une chronologie n'était qu'une première étape. En effet, même s'il s'appuie sur un contexte historique, mon projet a évolué au fil de mes réflexions sur les injustices vécues par toutes les personnes forcées de se déplacer, réfugiées ou en quête d'une vie meilleure, mais aussi par les peuples déjà établis, qui risquent d'être déplacés par l'arrivée de ces personnes.
- Pourquoi avez-vous choisi ce support et ces matériaux? En quoi leur utilisation a-t-elle remis en question ou élargi vos compétences en tant qu'artiste?
KVJ : Je travaille avec la couleur blanche depuis de nombreuses années. Je suis attirée par son caractère irréel, son lien avec l'éthéré et son sens du spirituel. J'aime aussi le fait qu'elle puisse être sale, polluée. C'est ce sentiment de tabou et de tension avec la personne qui regarde l'œuvre qui m'intéresse.
J'utilise beaucoup de tissus dans mon travail . J'aime apprendre de nouvelles techniques et expérimenter avec les matériaux, sortir des sentiers battus et voir ce qui est possible. J'ai un petit côté savante folle, et une fois que j'ai appris une technique et compris le processus de fabrication, je passe des heures à essayer de nouvelles façons de manipuler le matériau.
J'aime utiliser des matériaux contrastés : durs et doux, chers et bon marché, permanents et éphémères. Je passe beaucoup de temps à réfléchir aux matériaux et à choisir ceux qui reflètent les concepts que j'explore pour chaque projet. Pour moi, c'est important que les matériaux parlent des idées de l'œuvre. Depuis des décennies, je travaille avec divers matériaux, du verre soufflé à la soie. J'adore les combiner, pour que leurs caractéristiques distinctes surprennent et plaisent au public.
Pour ce projet, le film a pris une place plus importante. Par le passé, j’ai déjà utilisé des films de voyages en voiture : je projetais un lieu sur une œuvre que j’avais fabriquée et me servais de celle-ci comme écran. Mais pour cette oeuvre, j’ai expérimenté et exploré une surface différente sur laquelle projeter la vidéo, et j’ai utilisé une projection grandeur nature dans tout l’espace. Je me pose souvent beaucoup de questions hypothétiques lorsque je mets en place des laboratoires d'étude des matériaux dans mon studio. Alors que je réfléchissais à la création du porc-épic, je me suis demandé : « Et si j'utilisais des filaments de fibre optique comme piquants? Que se passera-t-il avec la vidéo? » « À quoi ressemblera la vidéo projetée sur du feutre opaque plat, sur de la résine, sur du sel? » Et puis j'ai essayé.
J'ai eu l'idée des messages dans la bouteille pendant la pandémie. J'ai commencé à réfléchir à ce qui était arrivé à toutes les personnes migrantes et réfugiées qui traversaient des eaux dangereuses à bord de bateaux lorsque le monde entier s'est arrêté. Les communications ont été largement interrompues. Ces personnes étaient-elles en sécurité? Avaient-elles trouvé refuge quelque part? Comment communiquer lorsqu'on est perdu, et peut-être en mer? J'ai commencé à faire des recherches sur les moyens de transport, et une partie de mes recherches m'a amenée à utiliser des bouteilles d'eau jetées pour construire des radeaux.
Je me suis lancé le défi de combiner le concept d'un radeau avec l'idée de messages dans une bouteille. Je me suis demandé : et si j'ajoutais un aspect communautaire en invitant les gens à écrire leurs propres messages privés, que j'intégrerais ensuite d'une manière ou d'une autre à l'œuvre? Cela combinerait cette idée fragile, mais pleine d'espoir, qui consiste à jeter un message à la mer en espérant qu'il sera trouvé et le concept de libération cathartique d'un fardeau personnel et même de guérison. Je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes seraient attirées par cette idée. Je recueille ces messages depuis 2022, alors que j'étais en résidence à la Galerie d'art Beaverbrook de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et j'inclus maintenant la communauté du Collège Dawson dans le projet. J'ai maintenant des centaines de messages privés. Je ne les ai jamais ouverts. Peut-être que je ne les ouvrirai jamais et que j'en ferai une capsule temporelle. Peut-être feront-ils partie d'un nouveau projet, ou d'une lecture publique à l'occasion de l'anniversaire de la pandémie. Pour l'instant, je les garde strictement privés.
J'aime l'art de l'installation et je considère l'espace occupé par l'œuvre comme une sorte de matériau à former. Je suis attirée par la possibilité de créer une expérience pour le spectateur, par exemple en lui offrant un aperçu de l'endroit, des sentiments, des moments de transition.
Je privilégie le médium de la sculpture d'installation, et je trouve que l'espace que les sculptures occupent est tout aussi important que les objets physiques. Pendant que je crée les sculptures, j'imagine également l'environnement dont l'œuvre s'inspire et la place qu'elle occupera. Il y a donc toujours deux aspects à mon travail : ce qui est fait dans l'atelier et l'installation. Chaque fois que je travaille sur une oeuvre, je pense toujours à son installation, et j'essaie de m'assurer qu'elle s'inscrira bien dans l'ambiance du lieu où elle sera exposée. J'aime que les lieux soient suffisamment aérés, qu'ils invitent à la contemplation et soient propices à la réflexion.
- Votre parcours est fascinant : vous avez beaucoup voyagé et mené une brillante carrière universitaire parallèlement à votre pratique artistique. De quelle manière vos diverses expériences de vie ont-elles influencé votre expression artistique et votre vision du monde?
KVJ : J'ai toujours eu envie d'explorer, d'apprendre, d'écouter et d'expérimenter. Je suis perméable à ce qui m'entoure, je suis de nature enthousiaste et j'éprouve de la curiosité pour le monde complexe et désordonné qui m'entoure. Dans le cadre de mon travail artistique, je m'efforce de montrer la complexité et de présenter des points de vue multiples.
Après le secondaire, j'ai participé à un programme parrainé par le gouvernement canadien, appelé Jeunesse Canada Monde. Cette organisation internationale sans but lucratif, qui n'existe plus aujourd'hui, jumelait des jeunes Canadiens à des jeunes de pays en développement. Avec leur homologue, les participants faisaient du bénévolat dans les secteurs du travail social ou de l'agriculture dans un petit village du Canada, puis dans un village du pays d'échange. Ma participation à un si jeune âge, qui m'a permis de passer la moitié d'une année avec une personne d'une culture différente, a changé ma vie. Je suis allée au Pakistan, j'ai vécu dans un petit village à la frontière afghane, et j'ai travaillé dans une petite clinique dans le désert qui desservait un rayon de 200 km dans la région. C'était juste après la guerre en Afghanistan et il y avait environ 3 millions de réfugiés au Pakistan à l'époque. Le Pakistan avait également été soumis à la loi martiale pendant plus d'une décennie et j'étais là lors des premières élections démocratiques, lorsque Benazir Bhutto a été élue à la tête du pays. L'un de mes souvenirs les plus marquants de cette période est la visite d'un camp de réfugiés de la Croix-Rouge pendant la mousson. Nous étions entourés d'eau dans une jeep alors que des centaines de tentes étaient emportées par les flots. La grande majorité des 82 millions de personnes déplacées de force dans le monde vivent dans des pays pauvres.
Nous avons également distribué de l'aide internationale. Une fois par mois, je donnais ½ tasse de ghee à une femme qui avait quatre enfants, et cela m'a vraiment fait prendre conscience de la complexité de l'aide, de la politique, de la pauvreté et de l'injustice. Mais j'ai aussi découvert de nouvelles façons de voir la communauté, la beauté, l'amitié et l'espoir. À mon retour, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des refuges pour femmes et des cuisines communautaires, et je continue de le faire. Peut-être que d'une certaine manière, ma vie quotidienne fait partie de ma pratique artistique, car je crois que je dois essayer d'exercer une influence positive sur la vie des autres, peu importe comment.
L'art est ma façon de me débattre de questions importantes et complexes. Étant donné ce degré de complexité, j'essaie de présenter des œuvres qui peuvent être lues et vécues de plusieurs façons. Ce n'est pas une démarche qui se veut didactique. J'y présente plutôt des méditations sur des questions sociales, humanitaires et environnementales que je m'efforce de décortiquer, mais je veux aussi présenter de l'espoir, de l'humour et de la beauté pour séduire le spectateur et l'amener à réfléchir, à sa manière et à son rythme, à des aspects inconfortables de la vie et à notre empreinte jusqu'à présent.
Sinon, mes voyages de recherche m'ont permis de m'immerger dans un lieu. En voyageant à l'île de Ré, en France, j'ai vraiment pu me doter d'une mémoire physique d'un lieu que j'ai essayé de transposer dans l'œuvre LifeBoat : an Unnatural History. J'ai pu établir un lien avec mon sujet au gré d'un tour de l'île à vélo, en explorant les jardins salés, en visitant l'église où mon ancêtre a été baptisé, et en m'imprégnant du rivage sauvage et accidenté. Parcourir une grande distance, entendre l'accent local, manger la nourriture locale, toucher le sol, noter les couleurs tonales et la palette unique de la région, écouter les bruits en regardant le paysage... toutes ces expériences m'ont aidé à créer.
D'une certaine manière, mes expériences de vie m'ont révélé à la fois mon insignifiance, mes ancrages et ma responsabilité.
- Comment pensez-vous que votre expérience de la réalisation de Lifeboat : An Unnatural History influencera l'orientation de votre travail à l'avenir?
KVJ : La création artistique est une expérience transformatrice. Il s'agit d'une perte et il faut faire preuve d'un certain lâcher-prise, mais nous avons toujours tendance à porter des résidus d'expériences et des thèmes dans d'autres projets. Je souhaite actuellement continuer d'explorer la projection vidéo sur des objets sculpturaux, comme je l'ai fait dans Lifeboat. J'aimerais aussi m'intéresser davantage aux questions environnementales. Je pressens donc un passage des animaux aux plantes, et un réengagement avec les formes biomorphiques et surréalistes. Par ailleurs, je prévois faire d'autres expériences avec les textiles, de nouvelles explorations dans le domaine du moulage et j'aimerais réaliser des vidéos en accéléré!